Littérature française
 Comme à la pêche aux canards, il faut bien sortir du lot un premier roman des 607 de cette rentrée littéraire.
Comme à la pêche aux canards, il faut bien sortir du lot un premier roman des 607 de cette rentrée littéraire.
Celui de Tom Lanoye piaffe, agite ses bras comme un enfant, demande qu’on le choisisse et saute tout seul hors de la boîte. Doit-on encore présenter le (vieil) enfant terrible de la littérature flamande qui écrit très haut, et très fort, ce que d’aucuns n’osent même pas penser tout bas ? Il s’empare de nos peurs de la décrépitude du corps, de l’affliction de l’âme, de l’étroitesse ou de la vanité absolue de nos vies… Des sujets qu’il traite à la manière d’un Francis bacon, déformant l’image et le trait, pour mettre au jour les ratés du destin et les folies des hommes. «La langue de ma mère» ou «aMamma Medea» l’ont hissé au sommet, et depuis, il ne quitte plus l’affiche. Car Tom Lanoye est notre Aristophane, il tutoie joyeusement les dieux qui assaisonnent au vinaigre des existences qu’on aimerait baignées de miel. Ce qui nous rend muet, le rend bavard, ce qui nous tétanise, lui donne l’énergie d’un lanceur de disque funky.
Il y a du Philip Roth et du Rabelais chez ce gantois zoulou (il vit la moitié du temps en Afrique du sud) qui aborde avec une belle santé, les sujets «difficiles» de la maladie, de la mort, du sexe tarifé, de la haine de soi et des autres. Son style tient du bagout de camelot qui vous attrape au marché, et vous vend un gadget dont vous n’avez nul besoin, uniquement parce qu’il a su vous surprendre, mêler l’humour, la drague et le talent. Ainsi fait Tom Lanoye, qui vampe son lecteur, liant dans une même phrase le tragique au rire énorme, le désespoir à la tendresse, les lettres aux arts ménagers. Sous le masque de la vulgarité se cache la beauté vraie, et l’amertume chez lui n’est tolérable que si elle se moque d’elle-même.
Accrochez vos ceintures, lire cet auteur, c’est accepter ce mélange deux temps, pétaradant, iconoclaste mais fraternel qui fustige le préjugé, l’hypocrisie et le conformisme. Jusque, et y compris, chez soi et parmi les siens. Si vous êtes comme lui, embarquez dans «Troisièmes noces» (La Différence), roulez jeunesse et accrochez vos ceintures.
Dès la première ligne, à n’en pas douter, nous sommes en Belgique, «il est dix heures du matin et la lumière est moche». Dans un café ostendais, non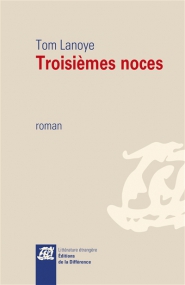 loin des masques d’Ensor, quelqu’un achète un nègre pour se marier en blanc avec une africaine. Maarten, notoirement homosexuel, chômeur de longue durée et sidéen, reçoit une coquette somme pour jouer les époux. Dix ans plus tôt, il vivait en couple avec une vraie chochotte, dont il ne reste que des théières kitsch, du mobilier art déco, un fond de remords et un peignoir chinois. Gaëtan est mort le premier, après des années de hargne conjugale. Veuf aigri, mis hors jeu du cinéma belge pour des compétences obsolètes et plus chères que le plan rosetta, Maarten passe son temps à visionner un documentaire sur les lévriers de course et à retarder le moment où il explosera, enfin, à coups de marteau les dauphins de mauvais goût de sa salle de bain. Cela remplit sa vie, jusqu’à l’arrivée d’une Tamara à la peau d’ébène, finaude, pas potiche du tout, et suffisamment néerlandophone pour lui tenir la dragée haute. avec dans ses valises de démunie, une générosité et une compassion pour nos propres misères. Une oralité truculente sans besoin de chausse-pied, Tom Lanoye case dans ce roman explosif, tous les problèmes de nos sociétés, le déclassement social, l’immigration dramatique, la faillite de l’intégration, le délitement des familles, la solitude absurde, et nos maladresses pour y remédier.
loin des masques d’Ensor, quelqu’un achète un nègre pour se marier en blanc avec une africaine. Maarten, notoirement homosexuel, chômeur de longue durée et sidéen, reçoit une coquette somme pour jouer les époux. Dix ans plus tôt, il vivait en couple avec une vraie chochotte, dont il ne reste que des théières kitsch, du mobilier art déco, un fond de remords et un peignoir chinois. Gaëtan est mort le premier, après des années de hargne conjugale. Veuf aigri, mis hors jeu du cinéma belge pour des compétences obsolètes et plus chères que le plan rosetta, Maarten passe son temps à visionner un documentaire sur les lévriers de course et à retarder le moment où il explosera, enfin, à coups de marteau les dauphins de mauvais goût de sa salle de bain. Cela remplit sa vie, jusqu’à l’arrivée d’une Tamara à la peau d’ébène, finaude, pas potiche du tout, et suffisamment néerlandophone pour lui tenir la dragée haute. avec dans ses valises de démunie, une générosité et une compassion pour nos propres misères. Une oralité truculente sans besoin de chausse-pied, Tom Lanoye case dans ce roman explosif, tous les problèmes de nos sociétés, le déclassement social, l’immigration dramatique, la faillite de l’intégration, le délitement des familles, la solitude absurde, et nos maladresses pour y remédier.
Dans un soliloque vertigineux, à l’oralité truculente, qui pousse le lyrisme jusque, et surtout, dans les sujets les plus scabreux, voire carrément pornographiques, «Troisièmes noces» met le doigt, si j’ose dire, là où cela fait mal. Avec une liberté désinvolte, un phrasé et une inventivité qui empruntent aussi bien au flamand qu’à l’anglais ou au français, merveilleusement rendu par la brillante traduction d’Alain Van Crugten. La redoutable efficacité de dialoguiste et de cadreur de Tom Lanoye, est doublée d’un art consommé de la digression, et du détail qui fustige, désarçonne et séduit. La poésie et l’émotion surgissent là où précisément on ne les attend pas. D’autant moins que le ton, de bout en bout, est celui d’une colère aigre mais jubilatoire, prête à exploser, comme une fusée éclairante.
Cette chronique de Sophie Creuz a été publiée dans l'Echo du samedi 23 août 2014.
 Beauchemin, nom prédestiné pour celui qui a frôlé la mort et revient ragaillardi parmi les vivants. L’auteur québécois, auteur du très remarquable « Le Jour des Corneilles »( Libretto) compose une ode à la vie, dans l’émerveillement de ce qu’elle a de meilleur à donner : la beauté d’un ciel et la chaleur de la fraternité. Ce petit livre, salue le rire salvateur, ressuscite les souvenirs d’enfance, s’approche avec pudeur d’un père, de l’amour d’une femme, d’une sœur, et rend grâce à l’existence ; à tous ces gestes, ces mots qui l’ont sauvé. Evitant la mièvrerie autant que l’affèterie, se tenant à l’écart de la spiritualité autant que de la sagesse de bazar, Jean-Christophe Beauchemin, d’une la plume claire, belle, aux images heureuses, dit simplement merci à la vie. Et à son chien, dont l’œil humide autant que sa truffe, ne l’a jamais abandonné.
Beauchemin, nom prédestiné pour celui qui a frôlé la mort et revient ragaillardi parmi les vivants. L’auteur québécois, auteur du très remarquable « Le Jour des Corneilles »( Libretto) compose une ode à la vie, dans l’émerveillement de ce qu’elle a de meilleur à donner : la beauté d’un ciel et la chaleur de la fraternité. Ce petit livre, salue le rire salvateur, ressuscite les souvenirs d’enfance, s’approche avec pudeur d’un père, de l’amour d’une femme, d’une sœur, et rend grâce à l’existence ; à tous ces gestes, ces mots qui l’ont sauvé. Evitant la mièvrerie autant que l’affèterie, se tenant à l’écart de la spiritualité autant que de la sagesse de bazar, Jean-Christophe Beauchemin, d’une la plume claire, belle, aux images heureuses, dit simplement merci à la vie. Et à son chien, dont l’œil humide autant que sa truffe, ne l’a jamais abandonné.
Jean-François Beauchemin : La fabrication de l'aube, Phébus, coll. Libretto, 112p, 6,70 €
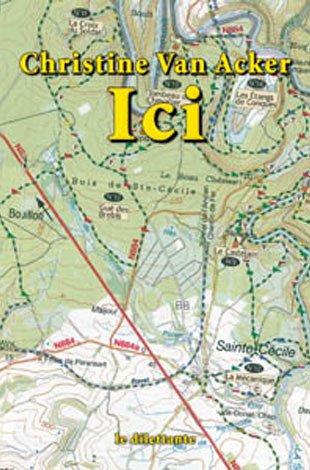 Non ce n’est pas du Geluck, mais du Van Acker, Ici étant l’improbable lieu-dit gaumais, où elle vit avec sa famille. Jadis à la campagne, écrit-elle, on se tuait à la tâche, aujourd’hui on y crève d’ennui. C’est pourtant là, que Christine Van Acker est partie vivre pour le plus grand plaisir des lecteurs de ses chroniques. Les a-t-elle écrites au cours des longues, trop longues soirées d’hiver ? Son œil de pie chaparde les saynètes de la vie d’un village déserté, que la civilisation n’atteint plus. Commerces de proximités fermés, bouffés par le zoning artisanal, jeunes sans emploi, font aussi partie du décor champêtre. Sans angélisme, mais avec beaucoup d’humour, l’auteur épingle d’un verbe vif, les us et coutumes des citadins en week-end, celles des gens du cru, et la cohabitation prudente, incrédule, qu’ils exercent avec les rats des villes reconvertis en rats des champs. Et elle ironise, avec un rien de cynisme, sur l’évolution de nos sociétés, qui asphyxie ses campagnes, supprime les gares, les bus, déplace les entreprises, mais multiplie les projets pour « renforcer les liens sociaux et intergénérationnels dans un souci de cohésion sociale »…
Non ce n’est pas du Geluck, mais du Van Acker, Ici étant l’improbable lieu-dit gaumais, où elle vit avec sa famille. Jadis à la campagne, écrit-elle, on se tuait à la tâche, aujourd’hui on y crève d’ennui. C’est pourtant là, que Christine Van Acker est partie vivre pour le plus grand plaisir des lecteurs de ses chroniques. Les a-t-elle écrites au cours des longues, trop longues soirées d’hiver ? Son œil de pie chaparde les saynètes de la vie d’un village déserté, que la civilisation n’atteint plus. Commerces de proximités fermés, bouffés par le zoning artisanal, jeunes sans emploi, font aussi partie du décor champêtre. Sans angélisme, mais avec beaucoup d’humour, l’auteur épingle d’un verbe vif, les us et coutumes des citadins en week-end, celles des gens du cru, et la cohabitation prudente, incrédule, qu’ils exercent avec les rats des villes reconvertis en rats des champs. Et elle ironise, avec un rien de cynisme, sur l’évolution de nos sociétés, qui asphyxie ses campagnes, supprime les gares, les bus, déplace les entreprises, mais multiplie les projets pour « renforcer les liens sociaux et intergénérationnels dans un souci de cohésion sociale »…
Christine Van Acker : Ici, Le Dilettante, 2014, 160p, 15€

